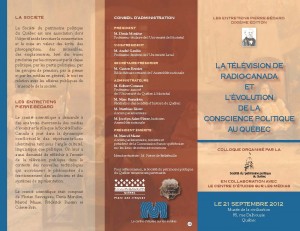Le colloque de l’automne 2013 de la soppoq porte sur les années 1950 au Québec. En évoquant d’emblée le caractère « glorieux » de cette époque, il s’agit de pousser plus loin la réflexion historienne sur cette décennie tout en suscitant des discussions et des débats. L’adjectif glorieux renvoie en effet ici non seulement, d’une part, à une identité nationale qui s’exprimait à travers la passion pour le club de hockey du Canadien de Montréal (les « Glorieux ») et une foi religieuse qui célébrait la gloire de Dieu, mais également, d’autre part, au début des Trente Glorieuses et aux « Fabulous Fifties » des États-Unis. Les années 1950 au Québec furent-elles réellement des années « glorieuses »? Si tel est le cas, en quel sens?
Pour mieux cerner ce questionnement, le colloque est organisé autour de trois séances.
-
Le Québec comparé: normalité ou anormalité?
La question de la normalité du Québec d’avant la Révolution tranquille, notamment des années 1950, taraude les chercheurs depuis un très grand nombre d’années. Alors que les historiens de l’après-guerre avaient généralement adhéré à une interprétation dépréciative de cette tranche du passé québécois centrée sur des retards structurels ou des caractéristiques culturelles qui seraient propres au Québec, ceux qui ont produit leurs œuvres maîtresses après les années 1970 ont proposé une vision dite « révisionniste » du développement de la société québécoise selon laquelle ce dernier suivait le rythme du développement urbain et industriel du reste de l’Amérique du Nord. Pourtant, jusqu’à maintenant, les études comparatives qui pourraient avantageusement alimenter ce débat sont peu nombreuses. Cette séance vise à ouvrir quelques champs de comparaison avec d’autres provinces canadiennes, les États-Unis ou d’autres régions du monde dans les domaines, par exemple, de la moralité politique, des conditions ouvrières, de l’éducation, de la place de la religion, de la natalité, de la condition féminine, etc.
- Objets emblématiques
La deuxième séance explore des objets emblématiques des années 1950. On mesure souvent mal en effet à quel point l’introduction de certains objets a eu un impact majeur sur l’évolution de la société québécoise. La place des femmes, les valeurs des jeunes, les loisirs de la classe moyenne ont été parfois bouleversés en profondeur par ces nouveautés. La simple invention du plastique a certainement eu une influence sur le cours du XXe siècle supérieure à l’élaboration de maintes idéologies qui, pourtant, ont davantage passionné les historiens. Il s’agit donc d’analyser l’impact de la création ou de la diffusion massive au Québec d’objets marquants aussi divers que la laveuse électrique, le 33 tours ou la télévision.
-
Lieux de mémoire
Tout le monde connaît le succès de la notion de « lieu de mémoire » dans les centres de recherche européens et américains d’histoire. C’est que cette notion permet de conjuguer l’analyse des faits historiques et celle de la mémoire collective. La troisième séance entend reprendre cet exercice et l’appliquer à certains « lieux » (définis de manière très large) qui évoquent, sur un mode à la fois symbolique et affectif, les temps forts du grand récit des Canadiens français devenus Québécois. Nous pensons entre autres à la banlieue, au chapelet en famille, au carnaval de Québec, etc.
La complémentarité d’une approche comparative de portée plus générale et d’une approche de portée plus spécifique centrée sur des lieux et des objets emblématiques promettent de brosser un portrait original, à la fois plus vivant et plus nuancé, d’une période charnière que les chercheurs, malgré des études déjà riches et volumineuses, n’ont pas épuisée.
Le colloque se tiendra le vendredi 18 octobre 2013 à l’Hôtel du Parlement, à Québec. Le coût d’inscription au colloque est de 20$.
Veuillez envoyer vos propositions de communications (350 mots) à Catherine Foisy avant le 1er février 2013 à l’adresse électronique suivante : foisy_catou@yahoo.ca
Membres du Comité scientifique :
Jean-Philippe Warren
Catherine Foisy
Dominique Foisy-Geofroy
Marcel Masse
Martin Pâquet
Matthias Rioux
Stéphane Savard
 La Société du patrimoine politique du Québec vous invite à un colloque commémorant le 50e anniversaire de la fondation du RIN comme parti politique le 1er mars 2013, à la Maison Ludger-Duvernay, au 82 Sherbrooke ouest, Montréal.
La Société du patrimoine politique du Québec vous invite à un colloque commémorant le 50e anniversaire de la fondation du RIN comme parti politique le 1er mars 2013, à la Maison Ludger-Duvernay, au 82 Sherbrooke ouest, Montréal.